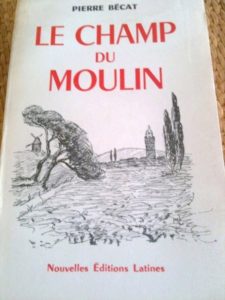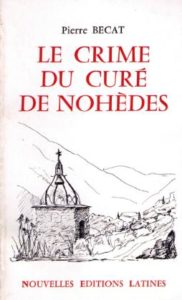Nous vous invitons à consulter le fascicule « Pierre Bécat, un regard sur l’histoire » (textes extraits de Regards sur la décadence) diffusé par le Groupe d’Action Royaliste, et disponible en format PDF à l’adresse suivante : http://www.calameo.com/books/00086931338f23ddb9d8b
Nous publions également un autre extrait de cet ouvrage, transmis et introduit par M. Frédéric Winckler du Groupe d’Action Royaliste, et publié sur le site http://www.actionroyaliste.com/.
J’ai passé de nombreux après-midi avec Pierre Becat, durant lesquels nous parlions des heures interminables sur ses souvenirs d’Action Française. De Pierre de Bénouville (résistant) et Jacques Renouvin (résistant, mort en déportation), anciens Camelots du Roi, qu’il avait bien connu, du Comte de Paris et tant d’autres souvenirs. Les lecteurs de Proudhon, les esprits libres y trouveront matière à réfléchir. Bref ceux qui tournent le dos au prêt à penser, qu’ils soient de sensibilité de gauche comme de droite, pourvu qu’ils aient encore dans les veines un sang « rebelle » face au monde uniforme qui approche. C’est en pensant à lui, que je publie ici quelques lignes ou nous retrouvons toute son analyse parfaite des évènements qui de la Révolution à aujourd’hui, illustrent la décadence Française…
La mort du maître de l’Empirisme Organisateur, méthode d’analyse historique, qui servira au gouvernement, d’occasion pour dissoudre les Ligues.
Cet empirisme qui annonçait la guerre arrivant, faisant suite aux clauses du mauvais traité de Versailles, « plus dure dans ce qu’il devait être tolérant et plus tendre dans ce qu’il devait être intransigeant…. ».
Comment l’absence de stratégie et le manque de diplomatie, précipitèrent l’Italie dans les bras d’Hitler, au nom de belles idées utopiques, annonciatrices de charniers…
Frédéric Winkler
Les obsèques de Jacques Bainville
Les obsèques de Jacques Bainville, écrivain, historien, journaliste, de l’Académie Française, ont eu lieu le 13 février 1936. Le corps du défunt avait été exposé dans la cour de l’immeuble où il habitait, rue de Bellechasse. A midi, dans ce local trop étroit pour contenir tous ceux qui s’y pressaient, deux discours furent prononcés : l’un par Léon Daudet, au nom des amis du défunt, l’autre par Me Henri Robert, directeur de l’Académie Française, parlant à titre personnel et en tant que représentant de l’illustre compagnie.
«La mort de Jacques Bainville, commença Henri Robert, est pour tous ceux qui l’ont connu, aimé et admiré, un sujet de profonde tristesse. Certes, nous le savions malade, atteint aux sources mêmes de la vie, mais nous voulions espérer quand même. II nous donnait l’exemple, en luttant avec un indomptable courage, un magnifique stoïcisme contre le mal qui le torturait. II avait auprès de lui, pour l’aider dans ce dur combat, sa femme dont les soins attentifs et l’inlassable dévouement réussirent par une sublime conspiration, à l’arracher plusieurs fois à son cruel destin.»
«Sa femme et son fils, ses confrères et ses amis ne sont pas les seuls à ressentir profondément la perte douloureuse qu’ils viennent de subir. Les Lettres françaises sont aussi en deuil. Maurice Donnay, en le recevant à l’Académie, a fait de notre confrère un magistral et définitif éloge.»«Dans les tristes circonstances présentes, je ne puis qu’évoquer son oeuvre. Jacques Bainville a écrit des livres qui ont con sacré sa grande réputation, et il est toujours resté fidèle au journalisme dans lequel il avait fait ses débuts, alors qu’il sortait à peine du lycée, en écrivant à Francisque Sarcey une lettre que celui-ci inséra dans Le Temps. Voir pour la première fois son nom imprimé dans les colonnes d’un grand journal, quelle joie et quel orgueil pour un collégien. Ce simple fait décida peut-être de sa vocation… »
Après ce discours qu’il serait trop long de reproduire en entier, Léon Daudet poursuivit :
«C’est comme vis-à-vis quotidien de Jacques Bainville, à notre table commune de travail de l’Action Française depuis vingt-huit ans, que je viens apporter à l’admirable veuve et au fils de notre cher ami, le suprême témoignage de notre douleur et aussi de notre fierté. Fierté que peuvent partager tous les collaborateurs de ce grand écrivain qui fut aussi un grand patriote.» «Eadem velle eadem nolle ea est vera amicitia. Vouloir les mêmes choses, ne pas vouloir les mêmes choses, voici la véritable amitié. La fidélité amicale de Bainville était connexe à la fidélité de ses convictions politiques. II disait de Charles Maurras qu’il lui devait tout sauf le jour. Cette formule pourrait être celle de la plupart d’entre nous. Tant de peines profondes et aussi de joies et de certitudes en commun ont créé entre nous, les maurrassiens, une solidarité que la mort même ne saurait anéantir. » «S’il est vrai que l’amour est plus fort que la mort, cela n’est pas moins vrai de l’amitié et au-delà des tombeaux quand il s’agit d’écrivains et d’hommes d’action, celle-ci se continue par leurs oeuvres, par leurs actes, par leurs intentions fraternelles.» «Amis, nous le fûmes dans la patrie, dans la France, notre mère, dont les dangers, les risques nous apparurent ensemble. Historien né, objectif et clairvoyant, pressentant les effets dans les causes comme un Thucydite et un Fustel de Coulanges, Bainville était atteint de cette transe des époques troubles : l’angoisse pour le pays. II n’était pas de jour qu’il ne m’en parlât ou n’y fît allusion. Poète par surcroît et de l’esprit le plus vif, le plus spontané, il voyait, navigateur des âges écoulés, monter à l’horizon les points noirs, annonciateurs de la tempête.» «Un article de lui dans la revue d’Action Française du 14 juillet 1914, intitulé Le Rêve serbe, annonce avec précision et clarté le mécanisme de la guerre européenne qui vient.»… «Sa plume ne tomba de ses mains qu’à la dernière minute. Jusqu’à ses derniers moments il s’entretint avec nous des sujets les plus divers, de ceux surtout qui lui tenaient au coeur. Cela nous permettait à nous, les collaborateurs de chaque jour, de lui cacher notre inquiétude.» «La veille de sa mort, il s’occupait avec Maurras de La Bruyère et il nous parlait de ses projets. Une seule plainte : quand pourrai-je reprendre avec vous nos petits dîners d’amis.» «Cher Bainville, tendre, délicat, grandiose ami, jusqu’à l’heure d’aller vous rejoindre, quand nous aurions dû vous précéder nous ne cesserons de penser à vous, de vous pleurer, de prier pour vous. »
Depuis lors, les événements n’ont fait que confirmer ce que nous savions déjà. Jacques Bainville était un esprit prophétique. C’est dans l’étude du passé, dans les profondeurs de l’Histoire qu’il lisait l’avenir. Entre autres prévisions, il avait annoncé, sept ans à l’avance, l’avènement d’Hindenbourg à la présidence de la république allemande. Peut-être alors, disait-il, mesurera-t-on l’aberration de notre politique. L’aveuglement de nos politiciens n’en persista pas moins. Et Hindenbourg eut toute latitude pour préparer la revanche en laissant la place à Hitler. La France était alors dans une de ces périodes tragiques, qui n’était pas la première depuis la Révolution et ne devait pas être la dernière, où chacun sent la catastrophe imminente, mais rares sont ceux qui osent l’annoncer. Cette sorte de léthargie permet aux gouvernements républicains de lancer le pays dans une guerre de diversion. Après quoi, il est interdit de douter de la victoire, faute d’être défaitiste. Et quand la défaite survient, laissant la France humiliée et meurtrie, les responsables s’en tirent en passant le fardeau aux innocents dont ils feront ensuite leurs accusés et leurs victimes.
C’était l’époque où Maurras écrivait : L’amour de l’Allemagne est une des maladies de la gauche française. Pourquoi ? Par ce que l’entreprise politique à laquelle la gauche, bon gré, mal gré, consciemment ou non, se trouve associée, est une entreprise d’anarchie et de barbarie dont les frais doivent être payés par tous les Français. La haine du passé français voue la gauche à cette fonction. La gauche s’était lancée dans une campagne acharnée contre Mussolini, notre allié le plus naturel, qui avait jusqu’alors empêché l’Anschluss en mobilisant sur le Brenner. Quant à l’Hitlérisme, elle ne s’en préoccupait point. Elle était même persuadée qu’en abandonnant la Sarre au Reich et en laissant les Allemands réoccuper la rive gauche du Rhin on aboutirait à une paix certaine. «Les chefs socialo-démocrates et communistes ont ruiné la propagande nazie», écrivait Léon Blum dans le Populaire du 12 janvier 1934. En fait, le plébiscite apportait à Hitler 90 % des votants. Confirmation aveuglante des résultats précédents qui n’avaient en rien modifié l’attitude des mêmes politiciens. C’est ainsi que dans le Populaire du 18 janvier 1932, on avait pu lire ces lignes, sous la même signature :«II est infiniment peu probable qu’une fois installé au gouvernement Hitler se livre à des provocations directes soit vis-à-vis de la France, soit même vis à-vis des puissances de l’Est. Révolutionnaire, il s’incline aujourd’hui devant la légalité allemande; il s’inclinera demain devant la légalité internationale.»
Or, en 1933 Hitler quittait la Société des Nations.
En mars 1935, il déchirait le Traité de Versailles et annonçait le réarmement de l’Allemagne.
En mars 1936, dénonçant le pacte de Locarno, il réoccupait en force la rive gauche du Rhin.
Seul, le député socialiste M. Grumbach, dans le Republikaner de Mulhouse, sans doute parce qu’Alsacien, se rallia aux démonstrations de Bainville. II s’était rendu compte que la victoire électorale des racistes de Hitler en Saxe avait coïncidé avec notre évacuation de la Rhénanie. En juin 1936, c’est l’avènement du Front Populaire. Hitler, complètement rassuré, se pose en défenseur de l’Italie à qui le gouvernement de la France applique rigoureusement «les sanctions», au sujet de l’Ethiopie. Seul, jusqu’alors, Mussolini s’était opposé à l’Anschluss, en mobilisant sur le Brenner en 1934. Désormais, il restera neutre. Hitler, n’ayant rien à redouter de la part de la France, décidera la réunion de tous les pays de langue allemande et occupera l’Autriche le 13 mars 1938.
Après avoir réussi son coup de force en Tchécoslovaquie, occupé Mémel, postérieurement aux accords de Munich, renforcé son alliance avec l’Italie et signé le pacte de neutralité germano-soviétique. Hitler se voit déclarer la guerre par le Front Populaire, au moment même, comme l’a dit Maurras, où il n’attendait que cela. Devant cette veulerie de l’Etat démocratique français, Bainville avait écrit avant sa mort : »Il ne sert à rien d’avoir raison.» Livrant au jour le jour le fruit de ses méditations, Jacques Bainville parlait peu, sauf avec quelques intimes : Léon Daudet, Maurras, Léon Bérard et certains autres qui ne concluaient pas comme lui à la nécessité de la monarchie, tel Raymond Poincaré qui était un de ses lecteurs assidus et un de ses admirateurs. Je n’ai pas oublié pour ma part une conversation prolongée que j’ai eu la chance d’avoir avec lui, après la parution de ses deux ouvrages que j’aime le moins : son Histoire de la Troisième République et son Napoléon. C’était dans son bureau de l’Action Française où il m’attendait seul pour m’entretenir d’une question juridique. L’essentiel étant dit, il me parla de Sainte-Beuve qui me parut être son auteur préféré. Ce grand observateur, dit-il, qui savait que l’homme à toutes les époques et dans tous les siècles se ressemble, qu’il a les mêmes passions, qu’il raisonne et se comporte de la même manière dans les mêmes cas. A son école, on ne croit pas que l’humanité date d’hier, qu’elle est différente aujourd’hui de ce qu’elle était autrefois, que les révolutions, les chemins de fer, le téléphone l’ont transformée. L’homme vit entre les convulsions de l’inquiétude et la léthargie de l’ennui. C’est à peu près le rythme de l’Histoire qui rend compte des évolutions et des guerres. L’homme ne change pas et il a besoin de gouvernements qui l’aident et le protègent. Ainsi que Napoléon, il considérait les institutions de l’Ancienne France comme les meilleures qui aient existé et qu’il suffisait, à chaque génération, de moderniser.
Encore jeune, Bainville n’avait pas atteint son apogée. Mais sa notoriété et son influence étaient telles qu’autour de son cercueil, au premier rang de l’assistance se pressaient les plus hautes personnalités de la politique et des lettres… Dans le cortège, précédé de deux chars remplis de fleurs et de couronnes, dont celles du duc et de la duchesse de Guise, on distinguait les très nombreuses délégations des journaux, avec entre autres Lucien Romier, Henri Massis, Louis d’Harcourt. Charles Maurras et la reine Amélie du Portugal suivaient aussitôt après la famille.
Tandis que cet imposant cortège s’engageait sur le Boulevard Saint-Germain, toutes sortes de délégations massées sur les côtés du boulevard et faisant la haie, se joignaient aussitôt à lui. De la rue de Bellechasse à la rue de l’Université, aux abords du Métro Solférino, les ligueurs de Paris et de la banlieue affluaient, ainsi que le groupe nombreux et discipliné des étudiants venus de la rue de l’Université et de la rue de Lille. La population parisienne, dans le plus profond recueillement, se découvrait devant cet impressionnant cortège qui défilait dans le plus profond silence. C’est alors que se produisit un incident qui devait avoir de graves répercussions sur la politique extérieure de la France. Tandis que Léon Blum, sortant de la Chambre des députés, regagnait en voiture son domicile, il se heurta au cortège funèbre. Le chauffeur prétendit qu’il avait stoppé aussitôt, mais reçu l’ordre de forcer le cortège. Indignés, des protestataires, dont certains n’étaient que spectateurs, s’interposèrent et cassèrent les vitres de la voiture. Léon Blum reçut des ecchymoses au visage et se fit conduire à l’Hôtel Dieu où il fut pansé immédiatement.
Quand il revint à la Chambre des députés, avec une mise en scène bien orchestrée, il fut accueilli par son parti aux cris de «Dissolution des Ligues». Et Albert Sarraut, ministre de l’Intérieur, fit signer, par le président fantoche Albert Lebrun, la dissolution de toutes les organisations d’Action Française que suivit celle de toutes les ligues nationales. Dans la situation inextricable où se débattait alors le gouvernement, au lendemain des émeutes du 6 février et à la veille de la préparation du Front populaire, dans la contexture d’une politique étrangère tendancieuse, il faut une explication logique.II semble exclu que Léon Blum, qui n’aimait ni la foule ni la bagarre, ait lui-même poussé son chauffeur à forcer un cortège funèbre, dans des conditions qui ne pouvaient que lui nuire. D’un autre côté, qui avait donné l’ordre au chauffeur d’aller de l’avant? Léon Blum n’était pas seul dans la voiture et il semble bien qu’elle ait été téléguidée. C’était d’ailleurs l’avis de Jean Chiappe qui s’y connaissait sur ce genre de complots. Au surplus, pour masquer les lugubres reflets de ce tableau déprimant, une certaine presse a prétendu que le chef socialiste molesté avait été délivré par un groupe d’ouvriers qui travail laient non loin de là. Or, cela n’a jamais existé. D’abord, il était plus de midi et demi, heure à laquelle les ouvriers ne sont pas au travail. En second lieu, les étudiants, ligueurs et membres du cortège n’ont porté la main sur aucun des occupants de la voiture. Les agents survenant n’ont procédé à aucune arrestation. Et d’ailleurs, jeunes et nombreux comme ils l’étaient, les protestataires, s’ils l’avaient voulu, auraient fait voltiger comme un hochet la voiture et ses occupants. Enfin, qu’auraient pu faire à leur encontre quelques ouvriers qui seraient intervenus?
II y avait là Maxime Réal del Sarte et sa redoutable équipe. Evidemment, cela fait bien de pouvoir dire que des ouvriers sont intervenus en tant que sauveteurs d’un chef socialiste en danger, comme si les socialistes avaient le monopole de la classe ouvrière qui, à Paris, on le voit aux élections municipales, est plutôt nationaliste. D’ailleurs, Léon Blum n’était pas député de Paris. Mis en échec dans la région parisienne, il s’était fait élire à Narbonne. Mais depuis la spoliation des entreprises de presse, on nous fa brique une petite histoire qui s’enracine peu à peu dans les esprits. A vrai dire, il fallait un prétexte pour dissoudre les ligues nationales qui s’insurgeaient contre une politique qui conduisait à la guerre. C’est Mandel qui disait que les démocraties ne se préparent à la guerre que si l’on les y engage d’abord. Pour éviter un nouveau 6 février, il fallait procéder à la dissolution des ligues et trouver un prétexte à cet effet. Le régime ne manquait pas de moyens. Mais il sortait amoindri des émeutes sanglantes, la disparition de Stavisky, du Conseiller Prince hantait encore toutes les mémoires. Les forces occultes de la république se sont rabattues sur un procédé macabre, sans se dissimuler pour autant que le stratagème aurait pu mal tourner.
Pierre Bécat, Regards sur la Décadence